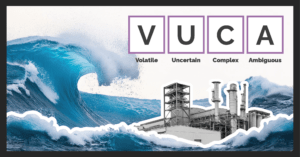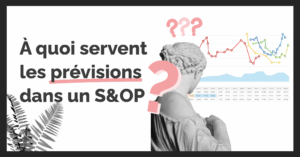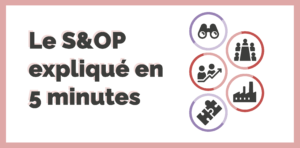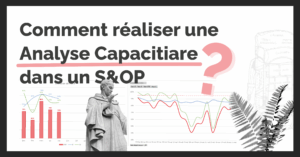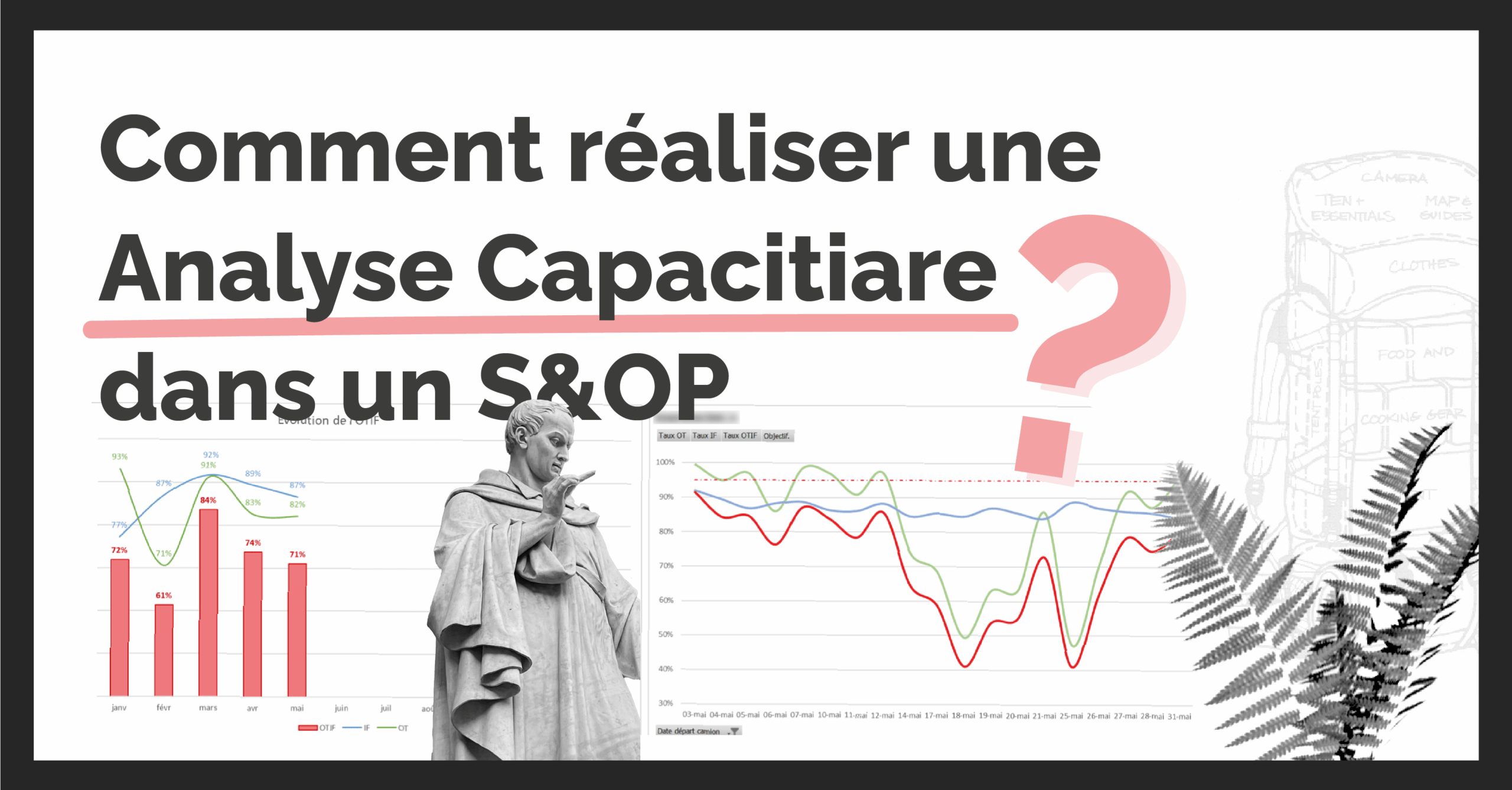
Faire une analyse capacitaire dans un S&OP, c’est mesurer si les ressources de production permettront de répondre à la demande prévue. Un exercice indispensable pour anticiper les goulots, sécuriser les livraisons et piloter son business plan. Avant de partir, il faut savoir jusqu’où on peut aller. Découvrez les étapes d’une analyse capacitaire bien menée.
Déroulé de l'article
Rappel : qu’est-ce que le S&OP ?
Le S&OP, ou, Sales & Operations Planning (Plan Industriel et Commercial en français), est un processus clé dans l’optimisation de la gestion des opérations d’une entreprise. Son objectif principal ? Aligner les ressources industrielles disponibles avec les prévisions de la Demande. En d’autres termes, le S&OP permet de garantir que votre production est en phase avec les besoins du marché, pour une meilleure performance globale.
À l’image d’une expédition scientifique, le S&OP permet à l’entreprise de mener à bien son business plan (vision de l’entreprise). Dans cette expédition, le S&OP permet de planifier et ajuster les moyens à mettre en œuvre pour arriver à destination et remplir les objectifs !
L’analyse capacitaire : un moment clé du processus S&OP
L’analyse capacitaire (Supply Review), pierre angulaire du processus S&OP, est un exercice mensuel essentiel pour garantir la satisfaction client et la rentabilité de l’entreprise.
Chaque mois, l’analyse capacitaire permet de déterminer les moyens nécessaires pour répondre à la demande prévisionnelle des clients, définie lors de la Revue de la Demande. Cet exercice fondamental permet d’ajuster les ressources en fonction des variations de la Demande, et ainsi optimiser l’allocation des moyens humains, matériels et financiers, minimiser les coûts et assurer la satisfaction des clients en fournissant les produits nécessaires au bon moment.
Si on file la métaphore de l’expédition, l’analyse capacitaire serait le travail de préparation du matériel, de recrutement des équipiers, la mobilisation des fonds nécessaires pour mener à bien le voyage. Quels sont les vêtements, outils ou instruments que je possède déjà ? Est-ce que cela est compatible avec mon type d’expédition, les besoins d’analyse sur place, et le climat rencontré ?
Pour un Industriel, il sera plutôt question de savoir quelle quantité on peut produire. Est-ce que cela permet de satisfaire les besoins clients et les objectifs stratégiques ?
Dans les deux cas, il faut pouvoir estimer sa capacité pour réagir vite aux imprévus.
Pourquoi réaliser une analyse capacitaire ?
Les entreprises évoluent aujourd’hui dans des contextes très volatils, où la Demande client évolue rapidement et les conditions d’approvisionnement également. Elles ont besoin de pouvoir réagir vite. Il est donc capital de faire une analyse capacitaire pour estimer les besoins à la hausse ou à la baisse en termes de production, de stock, de capacité logistique, de besoins de trésorerie, de besoins de matières premières…
Et ce tous les mois. Ainsi, les situations de sous-capacité ou de sur-capacité peuvent être anticipées et l’activité pilotée pour réaliser malgré tout le business plan. La Supply Review (ou Revue capacitaire en français) permet d’optimiser l’utilisation des ressources de l’entreprise. In fine, permet d’optimiser les coûts tout en garantissant une satisfaction client maximale.
Sans vérification du matériel (analyse capacitaire), cela revient à partir à l’aventure en risquant d’être trop chargé avec plein d’affaires inutiles (ex : sur-stocks). Ou au contraire, de ne pas avoir assez d’équipement pour survivre (ex : sous-effectifs). Faire cette analyse préalable, c’est être certain d’avoir le matériel adéquat aux besoins pour arriver à destination.
Qui est en charge de cette Supply Review ?
Pour garantir son efficacité, l’analyse capacitaire doit être menée par une fonction transverse de l’entreprise. La Supply Chain est généralement en charge de sa réalisation, sous l’impulsion d’un planificateur, d’un responsable planification ou d’un coordinateur S&OP, selon l’organisation.
Quelles sont les étapes d’une analyse capacitaire ?
1. Choisir l’horizon temporel et le détail des analyses
L’horizon temporel et la fréquence des cycles S&OP varient selon le secteur d’activité, mais un horizon de 18 mois et un détail des analyses au mois s’avèrent souvent pertinents pour répondre aux besoins moyen et long terme.
Cela facilite la prise de décision sur des sujets moyen terme (planification tactique) comme l’organisation de la production, la planification de la main d’œuvre, les approvisionnements… Mais également sur des sujets plus long terme (stratégique) tel des investissements, le développement d’expertises…
Un horizon minimum de 12 mois est généralement recommandé pour prendre en compte les phénomènes saisonniers. Et par ailleurs, les leviers d’actions possibles nécessitent la plupart du temps un certain délai avant de pouvoir être mis en oeuvre, d’où l’intérêt de réaliser cet exercice mensuellement dans le cadre du S&OP, avec un horizon de plusieurs mois permettant d’anticiper suffisamment ces actions.
2. Déterminer la capacité de production
Les paramètres à prendre en compte
Ensuite, plusieurs données sont nécessaires pour le calcul des capacités de production :
- Les périodes de fermeture de lignes (congés, formations…)
- La cadence nominale des machines installées
- Le rendement démontré
- Le schéma d’organisation prévu pour la production (1×8, 2×8, 3×8…)
- Les maintenances ou travaux envisagés
Tous les événements pouvant impacter significativement la capacité de production doivent être pris en compte. La collecte de toutes ces données nécessite un travail d’échange préalable et de coordination inter-services, entre la Supply Chain, la Production, les méthodes, la maintenance, le contrôle de gestion, les RH.
Conseil : penser à bien collecter toutes ces informations tous les mois
Item + Item + Item + Item dans bulle rêve = X jours de voyage et itinéraire en arrière plan
Si l’on reprend la préparation de notre expédition, le matériel actuellement à disposition qui va définir combien de jours on peut avancer en totale autonomie dans la jungle (kayak, machette, nourriture, panneau solaire…).
Le calcul des capacités des machines
Les temps d’ouverture prévus ainsi que les cadences nominales et les rendements permettent d’exprimer la capacité des machines en nombre d’unités (ex : la production de pièces mécaniques) ou en tonnes (ex : industries de process).
Il est primordial de prendre en compte des capacités démontrées des machines et non des capacités théoriques. Il faut donc vérifier le matériel comme avant une grande expédition. S’assurer que le sac pour les caméras est bien étanche, vérifier que le kayak n’est pas troué…
À lire également : Quels indicateurs de performance pour un S&OP ?
Le périmètre pour calculer la capacité de production
L’analyse capacitaire de l’ensemble des moyens de l’entreprise peut être consommatrice de temps et nécessiter de traiter un grand nombre de données. Il est capital de s’intéresser en priorité aux ressources critiques ou ressources goulot. Il est plus important de réfléchir à l’espace pris par l’alimentaire dans le sac-à-dos que celui occupé par les vêtements. Ça évite de perdre du temps sur un sujet qui n’est pas vital. Dans la même logique, dans l’usine, on regarde :
- Les lignes de production très sollicitées (ex : une machine à découper en 3×8)
- Les compétences clé avec une disponibilité limitée (ex : soudeurs techniques, automaticiens)
- Les matières premières ou les composants stratégiques (ex : sucre, huile, lithium, semi-conducteur)
Se concentrer sur ces ressources critiques permet de mettre en évidence les problématiques sur lesquelles agir en priorité, sans se noyer dans l’analyses de données trop nombreuses.
3. Déterminer la charge prévisionnelle
Puis, après avoir déterminé la capacité de production maximale, il faut pouvoir estimer la charge correspondant aux besoins clients prévus.
La donnée de départ est la prévision de la Demand review.
À cette étape, les stocks de produits finis existants doivent être pris en considération dans le calcul des besoins de fabrication. Le niveau de stock actuel (ou couverture de stock) conditionnera le moment où de nouvelles fabrications devront être lancées pour répondre à la demande. La prise en compte du niveau de stock permet de transformer les prévisions de vente en besoins de fabrication.
Ces besoins doivent ensuite être affectée aux outils de production. Ce lien se fait souvent dans l’ERP de l’entreprise, via les gammes de production et les nomenclatures.
Ces données permettent de convertir les besoins de produits finis en utilisation de ressources :
- Ressources d’ingénierie (selon les industries)
- Temps d’utilisation des machines
- Ressources humaines (ETP, type de compétences…)
- Quantité de matières premières, composants ou énergie nécessaire
4. Confronter la Charge et la Capacité
Cette étape permet de comparer, sur l’horizon de temps étudié, la capacité de production prévue par rapport à la charge prévisionnelle nécessaire pour couvrir les besoins clients. On met en évidence les périodes de surcapacité ou de sous-capacité et on estime les ajustements qui seraient nécessaires.
Après avoir regardé les prévisions météo et climatiques, avoir projeté ce que cela implique en termes de matériel nécessaire, il faut vérifier que l’équipement actuel permet de mener à bien cette expédition. En accord avec ces prévisions. Si ce n’est pas le cas, il va falloir faire des ajustements et imaginer des plans B !
L’analyse charge/capacité est souvent un processus itératif. On teste des ajustements (modification de la capacité de production, constitution de stocks en anticipation de périodes de sous-capacité…), on en mesure les coûts, les gains, les avantages et inconvénients et on évalue la complexité de mise en œuvre. Ceci permet d’établir les différents scénarios qui alimenteront la suite du processus S&OP.
Conclusion
La stratégie industrielle n’a de sens que si elle supporte la stratégie produit et service de l’entreprise et les ambitions de vente à long terme. Il est donc indispensable de clarifier au préalable les futurs besoins du marché, l’évolution du portefeuille de produits et services , d’estimer les volumes…pour calibrer au mieux les investissements industriels.
Mais on peut aussi imaginer qu’un avantage compétitif procuré par l’implantation des usines, la structure de coûts, la maitrise de certains procédés industriels uniques, permette à l’inverse de redessiner la stratégie business en s’appuyant sur cet avantage. L’important est l’alignement entre ces deux dimensions.
Articles qui pourraient vous intéresser également :