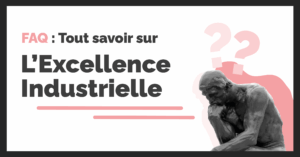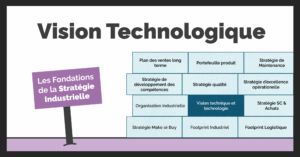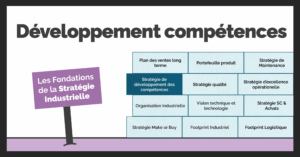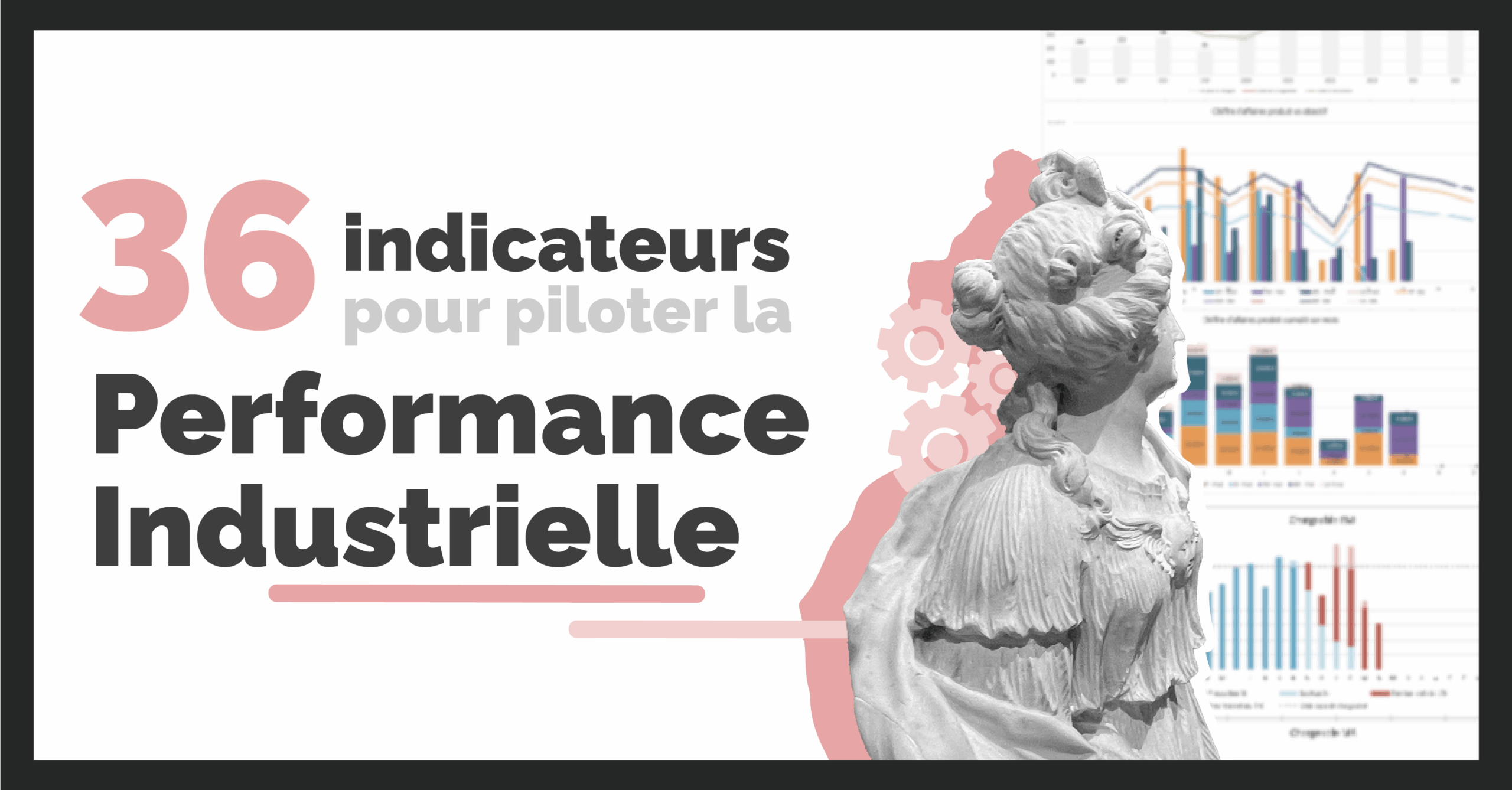
À rédiger
Déroulé de l'article
L’importance des indicateurs dans la gestion de la Performance Industrielle
Le paysage industriel contemporain est caractérisé par une incertitude et une complexité croissantes exigeant des entreprises une prise de décision rapide. En parallèle, la production de données de l’appareil industriel augmente de façon drastique et offre des opportunités nouvelles dans leur exploitation.
Dans ce contexte, les indicateurs clés de performance (KPIs) s’imposent comme des outils indispensables pour mesurer, suivre et gérer l’efficacité des diverses facettes opérationnelles. Ils déclinent les objectifs stratégiques en cibles mesurables. Permettant ainsi aux organisations d’évaluer leur performance industrielle, d’identifier les zones d’amélioration et de piloter des actions ciblées.
Un KPI doit permettre d’alerter en cas d’écart par rapport à un objectif, et déclencher un plan d’action. Sans ce mécanisme, son intérêt est limité. Cela implique donc l’existence de rituels au cours desquels les indicateurs sont partagés et analysés collectivement. En fournissant des informations exploitables, les KPIs donnent aux gestionnaires les moyens de dépasser la prise de décision intuitive, pour adopter une approche plus objective.
Dans cet article, nous proposons de vous donner une vision des 10 indicateurs principaux et essentiels (ou plus largement 10 familles de KPI) pour piloter votre activité industrielle. Retrouvez toutes les définitions, les méthodes de calcul, les interprétations pratiques et les implications stratégiques.
1. Les indicateurs de délai et service client
On-Time In Full (OTIF)
L’On-Time In Full (OTIF), ou Taux de livraison à l’heure et complet, est une métrique fondamentale pour tout industriel. Elle évalue la capacité d’une entreprise à livrer en totalité des produits ou services dans les délais convenus avec le client. Un OTIF élevé est clé pour développer la satisfaction client, fidéliser et établir une relation de confiance.
Dans certains secteurs travaillant en flux tendus, comme l’automobile, c’est un indicateur scruté de très près et sur lequel sont fixées des pénalités importantes, car le non respect de l’OTIF peut arrêter une chaîne de fabrication avec des millions d’euros d’impact à la clé. Un bon OTIF est synonyme d’efficacité opérationnelle et de maîtrise de la supply chain. Le calcul de l’OTIF s’effectue généralement selon la formule suivante :
OTIF = Nombre de livraisons à temps et complètes / Nombre total de livraisons.Il est donc impératif de définir de manière explicite ce qui constitue une livraison « à temps et complète ». Faut-il évaluer le respect d’une date exacte ou d’une fenêtre de jours (entre J et J+3 par exemple) ? Il est aussi important de se mettre d’accord sur la date de référence. Est-ce la date fixée initialement par le client ? La date confirmée par l’Accusé de Réception ? La date mise à jour suite à un retard annoncé au cours du processus de production ?
La bonne pratique est de conserver la date initiale validée avec le client et de calculer l’OTIF sur cette base. Bien sûr, si le client demande à la modifier, alors cette nouvelle date devient la référence.
Pour que les métriques OTIF soient véritablement utiles et exploitables, il est essentiel que toutes les parties prenantes internes et les partenaires externes (comme les fournisseurs) s’accordent sur des définitions précises et des méthodologies de calcul non ambiguës. Sans cette rigueur, la métrique perd de son intégrité, conduisant à des évaluations de performance trompeuses et à des décisions inadaptées.
La performance OTIF est fortement influencée par les choix de stratégie industrielle (production sur stock ou à la commande), la politique de stocks, l’efficacité des processus de fabrication, la performance des fournisseurs et la maîtrise de la planification et de l’ordonnancement.
Indicateurs associés à l’OTIF
Plusieurs autres indicateurs méritent d’être cités pour mieux suivre les délais et respecter les engagements client.
Adhérence au planning de production
L’adhérence au planning de production mesure la fidélité avec laquelle les équipes exécutent les plans de production établis. Elle se calcule comme suit :
Taux d'Adhérence au Planning = 1 - (abs (Volumes produits - Volumes planifiés) / Volumes planifiés). Une forte adhérence au planning témoigne d’une exécution des plans conforme aux attentes, avec peu d’aléas et d’urgences. Mais attention, si une bonne adhérence au planning est une condition indispensable pour délivrer un bon OTIF, les 2 indicateurs peuvent être partiellement déconnectés.
En effet, on peut respecter un planning de production sans pour autant livrer le client à l’heure. Par exemple, les capacités de production sont saturées et l’on ne peut pas planifier au-delà de ces capacités.
OTIF interne
Si l’OTIF est avant tout fait pour mesurer le niveau de service d’une usine par rapport à ses clients externes, on peut le décliner sur les opérations internes. Cet indicateur mesure alors la livraison à temps des produits ou services à chaque étape intermédiaire du processus de conception, d’industrialisation ou de fabrication.
On identifie ainsi mieux où sont les étapes critiques, les goulots qui peinent à respecter les délais fixés et affectent in fine l’OTIF client. En particulier, si la production se plaint de recevoir les plans et les gammes en retard, il peut être intéressant de positionner une mesure d’OTIF entre les équipes R&D/méthodes et production.
OTIF Fournisseur
L’OTIF Fournisseur évalue la capacité des fournisseurs à livrer leurs produits ou matières premières dans les délais convenus. C’est le miroir de l’OTIF client. Un OTIF fournisseur élevé garantit une chaîne d’approvisionnement stable et fiable. Il aura un impact positif sur l’OTIF client. Théoriquement, il faut aligner les 2 niveaux d’OTIF pour être cohérent et éviter de courir en production pour rattraper des retards fournisseurs.
Lead Time client
Le Lead Time client représente la durée totale d’attente d’un client entre sa commande et la réception de l’article commandé. Les éléments inclus dans ce calcul diffèrent selon la stratégie industrielle.
Dans le cadre d’une stratégie Make-to-Stock, où le produit est déjà prêt à être expédié depuis un entrepôt, on ne retiendra que le temps de traitement de commande, d’éventuels temps d’attente et la préparation de l’expédition. Le temps de fabrication en amont ne sera pas comptabilisé.
En revanche, pour une approche Make-to-Order, où l’on fabrique à la commande, on intégrera toutes les étapes amont, parfois jusqu’au développement d’adaptations produit.
Un Lead Time court permet aux entreprises de réduire les encours et de facturer plus rapidement leurs clients. Il permet aussi de répondre à des exigences de délais client, qui peuvent être standards selon les industries.
Des délais qui s’allongent sont le signe d’un engorgement de l’appareil productif. Si ce sont les temps d’attente qui augmentent, c’est le signal d’un dysfonctionnement. Suivre dans le temps l’évolution des lead time permet de s’assurer que l’on reste bien conforme aux promesses commerciales.
Temps de traversée
Contrairement à l’indicateur précédent, on va ici cumuler les temps de toutes les étapes de fabrication du produit. C’est le temps nécessaire pour qu’un produit sorte de l’usine en incluant les temps d’attente, les temps logistiques de manutention et les temps de process. Il peut être égal au lead time client si aucun point de découplage n’est positionné dans la chaîne de fabrication, sous forme de stocks de semi-finis ou de produits finis.
2. Les indicateurs de productivité
Taux de Rendement Synthétique (TRS) ou OEE
Le Taux de Rendement Synthétique (TRS), également connu sous son acronyme anglais Overall Equipment Effectiveness (OEE), est l’indicateur qui permet d’évaluer l’efficacité d’un outil de production. Il quantifie le pourcentage du temps de fabrication qui est réellement productif, en tenant compte de toutes les pertes.
Le TRS est une référence incontournable dans les démarches de performance industrielle. Il identifie les domaines d’amélioration potentiels. Son application permet de détecter les gaspillages et d’engager les équipes dans une démarche d’amélioration continue.
Le TRS est le produit de trois facteurs, chacun représentant une catégorie de pertes dans le processus de production :
Disponibilité
La disponibilité exprime la proportion du temps pendant lequel la machine est effectivement capable de produire, par rapport à la durée pendant laquelle elle était censée fonctionner (temps de production planifié). Elle est affectée par les arrêts non planifiés, tels que les pannes, le manque de matières premières, l’attente de personnel ou encore les temps de changement de série. La formule de calcul est :
Disponibilité = Temps de fonctionnement réel / Temps de production planifiéPerformance
La performance mesure si la machine fonctionne à la vitesse optimale attendue, c’est-à-dire à sa cadence théorique. Elle prend en compte les micro-arrêts et les baisses de cadence, qui font que le processus de fabrication fonctionne à une vitesse inférieure à sa vitesse maximale possible. La formule de calcul est :
Performance = (Temps de cycle idéal × Nombre de pièces total) / Temps d'exécution.La performance ne devrait jamais dépasser 100%. Un résultat supérieur indique généralement une définition incorrecte du temps de cycle idéal.
Qualité
La qualité prend en considération les pièces fabriquées qui ne répondent pas aux normes de qualité, y compris celles qui nécessitent une retouche ou sont mises au rebut. La formule de calcul est :
Qualité = Nombre de bonnes pièces / Nombre de pièces total ou (Quantité de bonne qualité / Quantité produite).Logiquement, la formule générale du TRS est la suivante :
TRS = Disponibilité × Performance × Qualité.Par exemple, si la Disponibilité est de 80%, la Performance de 80% et la Qualité de 90%, alors le TRS sera de 0,80 × 0,80 × 0,90 = 0,576, soit 57,6%
Le TRS est bien plus qu’un simple score d’efficacité global. Il constitue un puissant outil de diagnostic. Sa structure, qui décompose les pertes en disponibilité, performance et qualité, permet d’identifier précisément la source des problèmes. Par exemple : les pannes de machines, l’inefficacité des opérateurs ou les problèmes de qualité.
Cette clarté permet à la direction de cibler les causes profondes et de mettre en œuvre des actions d’amélioration spécifiques. On peut imaginer de la maintenance préventive pour la disponibilité, la formation des opérateurs pour la performance, ou le contrôle des processus pour la qualité.
Au-delà de son utilité technique, le TRS est un levier puissant pour l’engagement des employés et pour l’instauration d’une culture d’amélioration continue (Kaizen). Lorsque les opérateurs et les équipes de maintenance comprennent comment leurs actions quotidiennes influencent directement la disponibilité, la performance et la qualité, ils sont davantage en mesure d’identifier et de résoudre les problèmes. Cela favorise une dynamique d’amélioration ascendante, transformant un indicateur de haut niveau en un outil d’action opérationnel.
Indicateurs associés au TRS
TRG (Taux de Rendement Global) et TRE (Taux de Rendement Économique)
Ces indicateurs sont proches du TRS, mais partent de l’hypothèse d’un temps disponible plus important.
Le TRG prend en compte le temps d’ouverture complet du site. Il inclut donc tous les arrêts planifiés, les temps de formation, les réunions qui peuvent arrêter la production. On exclura ici les temps ou le site est fermé (week-end, nuits…).
Le TRE, en revanche, compare la production réalisée par rapport au temps total disponible sur une journée avec une organisation en 3×8.
Ces mesures sont moins utilisées que le TRS et peuvent fausser la vision de la performance et des objectifs à atteindre. En effet, certains sites n’ont pas la possibilité, ou le besoin, de travailler de nuit ou les week-end. Il est donc impossible de dépasser un certain niveau de TRE par exemple.
Utilisation des Capacités
Le taux d’utilisation des capacités de production est le rapport entre le temps d’utilisation des capacités de production et le temps d’ouverture du site. Il s’agit du rapport entre le temps de production réel (excluant les arrêts planifiés et non planifiés) et le temps de production théorique maximale d’une usine ou d’une machine.
Une machine qui tourne 6h sur 8h d’ouverture aura un taux d’utilisation de 75%. L’utilisation des capacités mesure l’exploitation du potentiel total de production, qui peut être plus large que le simple temps de fonctionnement planifié.
Débit de production
Le débit de production mesure la cadence à laquelle les produits sont fabriqués dans une période de temps donnée. Il permet de suivre l’efficacité d’une ligne de production et d’identifier des baisses de performance dues à des pannes, des ralentissements ou des goulots d’étranglement.
Débit de production = Nombre d'unités produites / Temps (heures, jours, mois)Temps de cycle
Le temps de cycle mesure le temps écoulé entre le début et la fin d’une opération pour fabriquer un produit donné. C’est une référence à connaître pour évaluer la performance d’un poste de production ou d’une ligne.
Temps de cycle= (Nombre d’unités produites) / (Temps total de production)Respect des temps gamme
Cet indicateur permet de s’assurer que les temps définis dans les gammes de fabrication sont respectés. Il peut mettre en lumière des dépassements réguliers de temps passé par rapport à la théorie. Et donc, on peut questionner soit la performance des opérateurs et des machines, soit la cohérence du temps gammé.
Pour le calculer, il faut que les temps réels soient mesurés, et que ces mesures soient correctes (des oublis de scan d’OF en début d’opération vont fausser la durée calculée). La formule de calcul est la suivante :
Respect des temps gamme = (Temps réel passé) / (Temps alloué en gamme).Chiffre d’affaires produit / m²
Cet indicateur mesure la valeur monétaire de la production générée par unité de surface de l’usine ou de l’espace de production. Il est particulièrement pertinent pour des sites où l’optimisation spatiale est un enjeu majeur (Ex : les usines avec des machines coûteuses ou des coûts immobiliers importants). Il contribue à maximiser le retour sur investissement des infrastructures physiques.
3. Les indicateurs de volume
Volume et Chiffre d’Affaires de production
Le chiffre d’affaires d’une usine représente la somme des valeurs des produits fabriqués par le site et vendus à des clients. Il peut parfois se distinguer du chiffre d’affaires de vente, s’il y a un décalage entre la production et la facturation. La notion de volume associée est également indispensable et plus parlante pour tous les acteurs de la production.
Le chiffre d’affaires produit aura pour avantage de prendre partiellement en compte les différences de complexité dans les produits vendus (plus un produit est complexe et plus il est vendu à des prix élevés). Alors que des volumes consolidés (nombre d’unités produites totales, tonnage…) peuvent gommer cette diversité et fausser les analyses capacitaires.
Le volume, qu’il soit mesuré par le chiffre d’affaires produit ou par les volumes physiques, est un indicateur de marché, mais pas nécessairement de performance interne. Un volume de ventes élevé est souvent perçu positivement, mais il ne garantit pas automatiquement l’efficacité opérationnelle ou la rentabilité. Une augmentation des ventes pourrait être le résultat d’une politique de prix agressive, ce qui pourrait réduire les marges. De plus, se concentrer uniquement sur le volume des ventes sans tenir compte de la capacité de production ou de la gestion des stocks peut entraîner une surproduction, une augmentation des coûts ou une surcharge des ressources.
Par conséquent, les KPIs de volume doivent être analysés en parallèle avec les indicateurs de productivité, de coûts et de cash pour fournir une vue équilibrée de la performance globale. Enfin, pour les entreprises avec des cycles de production longs, le simple chiffre d’affaires peut être trompeur si une part importante du travail est en cours, mais pas encore expédié.
4. Les indicateurs de rentabilité
Marge sur coûts variables
Il n’est pas nécessaire d’expliquer, ici, l’intérêt de piloter sa rentabilité et donc sa marge. C’est un basique de gestion d’entreprise. Mais si on se focalise purement sur l’activité industrielle, on doit regarder plus spécifiquement la marge sur coûts variables.
Elle représente la part de chaque euro de chiffre d’affaires qui reste une fois que les coûts variables (ceux qui évoluent proportionnellement au volume d’activité, comme les matières premières, la main d’oeuvre directe, les frais de transport ou d’emballage) ont été déduits. En d’autres termes, c’est le montant qui contribue à la couverture des coûts fixes (loyers, salaires indirects, etc.) et au-delà, à la génération du bénéfice.
Une analyse de la marge sur coûts variables par produit, par client ou par canal de distribution permet de déterminer les activités les plus rentables, et donc d’orienter les efforts de vente ou de production.
Une marge sur coûts variables élevée indique une bonne maîtrise des coûts variables et une forte capacité à générer du profit en cas d’augmentation des volumes. Tandis qu’une marge sur coûts variables faible peut alerter sur la nécessité d’optimiser les processus de production ou de renégocier les prix d’achat.
Attention, des décisions prises uniquement sur la base de l’analyse de la marge nette (incluant donc une quote part des coûts fixes) peuvent se révéler biaisées. En effet, un produit peut avoir une marge nette faible, voire négative. Mais si les ressources à mobiliser pour le fabriquer ne sont pas saturées, il est tout à fait pertinent de le produire pour maximiser l’utilisation des ressources de production et réduire ainsi les coûts fixes par unité vendue.
Indicateurs de rentabilité associé à la marge sur coûts variables
La marge contributive est souvent utilisée de manière interchangeable avec la marge sur coûts variables, bien qu’elle puisse avoir une signification plus spécifique.
Dans le contexte de la production, la notion de marge contributive prend une dimension stratégique particulièrement importante lorsque l’on est confronté à des goulots d’étranglement. Si l’on ne peut pas produire à l’infini, il faut donc choisir quels produits fabriquer pour maximiser son profit. Il devient alors impératif de ne pas se concentrer uniquement sur les produits ayant la marge contributive la plus élevée en valeur absolue.
La bonne approche consiste à calculer la marge contributive par unité de facteur de production rare. C’est-à-dire par unité de temps, de capacité machine ou de matière première consommée par le goulot d’étranglement.
Par exemple, si une machine est le goulot d’étranglement et que son temps d’utilisation est le facteur limitant, il est plus pertinent de privilégier les produits qui génèrent la plus grande marge contributive par heure de fonctionnement de cette machine. Un produit A peut avoir une marge contributive plus faible qu’un produit B, mais s’il est beaucoup plus rapide à produire sur la machine-goulot, il peut être plus rentable de le fabriquer en priorité. Cette logique permet de saturer la ressource la plus limitée avec les productions qui génèrent le plus de valeur, maximisant ainsi la rentabilité globale de l’entreprise, malgré la contrainte de production.
Au global, le suivi et la maîtrise des coûts de production, qu’ils soient fixes ou variables, est nécessaire pour piloter au mieux la rentabilité de l’entreprise. Leur optimisation exige une analyse approfondie des processus opérationnels, l’identification et l’élimination des gaspillages (conformément aux principes du Lean Manufacturing). Cela établit un lien direct avec les KPIs de « Productivité » et de « Qualité« , car la non-qualité (retouches, rebuts) et une faible productivité augmentent directement les coûts.
5. Les indicateurs de stock
Rotation des stocks
La rotation des stocks est un ratio financier qui mesure la vitesse à laquelle une entreprise vend et renouvelle ses stocks sur une période donnée. Elle indique combien de fois le stock total a été vendu et remplacé au cours de cette période. La formule principale pour calculer la rotation des stocks est :
Rotation des Stocks = Coût des Marchandises Vendues / Valeur Moyenne des Stocks.Alternativement, la rotation des stocks peut être calculée en divisant le chiffre d’affaires par le stock moyen au prix de vente.
Une rotation élevée des stocks indique que les produits sont rapidement convertis en liquidités, ce qui optimise le besoin en fonds de roulement (BFR) et améliore la trésorerie de l’entreprise. À l’inverse, une rotation faible peut signifier qu’une part importante du capital est immobilisée dans des stocks qui s’écoulent lentement, voire pas du tout.
De plus, un taux de rotation élevé contribue également à la réduction des coûts de détention des stocks, ce qui inclut les frais de stockage, d’assurance et la dépréciation des produits. Une rotation rapide minimise également le risque d’obsolescence, un enjeu crucial pour les produits périssables ou ceux dont la technologie évolue rapidement. Enfin, un ratio de rotation élevé est le reflet d’une bonne collaboration avec les fournisseurs et d’une capacité efficace à répondre à la demande des clients. Cela témoigne ainsi de l’efficacité globale de la Supply Chain.
Cependant, un turnover excessivement élevé pourrait également signaler des niveaux de stock insuffisants, potentiellement menant à des ruptures de stock et des ventes perdues.
Le taux de rotation optimal est un équilibre qui garantit la disponibilité des produits tout en minimisant l’immobilisation du capital et le risque d’obsolescence. Il y a des liens directs avec les KPIs de « Délai client » (en particulier l’OTD fournisseur) et de « Volume ».
Indicateurs associés à la rotation des stocks
Couverture de stock
La couverture de stock correspond au nombre de jours de chiffre d’affaires que le stock permet de couvrir. Il peut se calculer pour un ensemble de produits, mais il est plus pertinent de le calculer à la famille, voire à la référence produit. En effet, un chiffre consolidé peut cacher de grandes disparités avec des surstocks et sous-stocks s’annulant.
La bonne pratique est plutôt de définir des classes de couverture (<1 mois, entre 1 et 3 mois…) et de comptabiliser le nombre d’articles dans chaque classe.
Plus le nombre de jours de couverture est élevé, et plus le temps pour écouler ces stocks est élevé, plus la rotation sera faible. Il ne peut pas y avoir d’objectif dans l’absolu, car le niveau de stock dépend de beaucoup de paramètres : lead time d’appro ou de fabrication, délai souhaité par le client, risque d’obsolescence, coût…
Néanmoins, une règle simple consiste à regarder de plus près les stocks supérieurs à 3 mois de consommation.
Couverture de stock = (Valeur Moyenne des Stocks / Coût des Marchandises Vendues) × 365
ou
Couverture de stock = (Nombre d’unités en Stock / Consommation Moyenne) x 365Classification ABC et FMR
Il ne s’agit pas exactement d’un indicateur, mais plutôt d’une analyse. Elle peut être menée à intervalle régulier et permet d’établir un état des lieux précis des stocks selon 2 paramètres : la valeur de consommation (analyse ABC) et la fréquence de consommation (analyse FMR).
La classification ABC, issue de la loi de Pareto (le principe des 80/20), permet de hiérarchiser les articles selon leur valeur de consommation annuelle.
- La classe A : regroupe les articles qui représentent environ 80 % de la valeur totale du stock. Ce sont des articles hautement stratégiques qui nécessitent un suivi serré et une attention constante.
- La classe B : concerne les articles qui génèrent environ 15 % de la valeur.
- La classe C : (la majorité des références) ne pèse que pour les 5 % restants de la valeur. Leur gestion peut être moins rigoureuse, voire automatisée.
L’analyse FMR (Fast, Medium, et Rare) vient compléter l’approche ABC en ajoutant un critère de dynamisme. Elle évalue la fréquence de consommation de chaque article.
- Fast Movers (F) : Produits à rotation rapide, souvent commandés et consommés.
- Medium Movers (M) : Articles à rotation moyenne.
- Slow Movers (R) : Articles rarement consommés.
En combinant ces deux analyses (ABC et FMR), on peut créer une matrice qui révèle une image beaucoup plus fine et plus opérationnelle de l’inventaire. Un article « A-F » (Haute valeur, rotation rapide) ne sera pas géré de la même manière qu’un article « C-R » (Basse valeur, rotation rare). Le premier justifiera des prévisions précises et des réapprovisionnements fréquents, tandis que le second pourra être géré avec des stocks de sécurité ou une politique de réapprovisionnement à la demande. Cette approche ciblée permet de libérer des ressources financières et humaines, et d’améliorer le taux de service client.
6. Les indicateurs de qualité
Taux de Non-Qualité
La non-qualité est définie comme l’écart mesuré entre la qualité souhaitée et celle réellement obtenue. Elle englobe tout ce qui est mal produit et ne peut être livré tel quel au client (à ne pas confondre avec de la qualité interne). Cela comprend également les produits défaillants livrés aux clients et faisant l’objet d’une réclamation ou d’un retour en garantie.
On peut objectiver le niveau de non-qualité en mesurant le nombre de produits défectueux vs le nombre total de produits fabriqués. Pour les industries à gros volume, on calculera ce rapport par million de produits fabriqués.
Taux de non-qualité = nombre de produits défectueux/ nombre de produits fabriquésIndicateurs associés au Taux de Non-Qualité
On Quality Delivery (OQD)
Le concept d’OQD, pour « On Quality Delivery », se réfère spécifiquement au ratio des livraisons qui ne font l’objet d’aucune objection de la part du client, par rapport à la quantité totale de livraisons effectuées. C’est un indicateur complémentaire de l’OTD.
On Quality Delivery = (Nombre de livraisons sans problème qualité / Nombre de livraisons total)Coût de la non-qualité
La non-qualité est souvent comparée à un « iceberg » de coûts. Les coûts visibles, tels que les rebuts et les retouches, ne représentent qu’une petite partie du coût total. Tandis qu’une « partie immergée » plus massive inclut des éléments comme la perte de confiance des clients, la dégradation de l’image de marque et les parts de marché perdues.
Nous n’inclurons ici que les coûts visibles et quantifiables, les opportunités futures perdues auprès des clients étant plus difficiles à estimer. Ils peuvent s’exprimer en valeur absolue ou en pourcentage du CA produit pour être plus parlant.
Coût de la non-qualité = coûts des rebuts + coûts des retouches + coûts des réclamations client + coûts de garantieTaux de Rebut
Le niveau de rebut est le pourcentage de produits mis au rebut durant la fabrication. Il mesure la quantité de produits qui, en raison de défauts de fabrication, sont considérés comme non conformes et ne peuvent pas être vendus ou retravaillés. Il se focalise donc uniquement sur la non-qualité interne, non visible par le client.
Taux de Rebut = (Nb de pièces défectueuses / Nb total pièces produites) Taux de Réclamation Client
La non-qualité exportée, visible par le client, est suivie via l’indicateur du taux de réclamation client. Il mesure la proportion de clients qui ont formulé une plainte ou une réclamation au cours d’une période donnée. Un taux faible indique une bonne satisfaction client, tandis qu’un taux élevé signale des problèmes de qualité, de service ou d’expérience client.
Taux de Réclamation Client = (Nb réclamations / Nb total de commandes)Right First Time (RFT)
Le Right First Time (RFT) est un indicateur de l’efficacité des processus. Alors que des métriques comme le taux de rebut et le taux de réclamation client sont réactives (mesurant les défaillances après qu’elles se soient produites), le RFT mesure la capacité d’un processus à produire correctement sans défaut dès la première fois. Un RFT élevé indique des processus robustes, une formation efficace et un contrôle qualité rigoureux intégré tout au long du flux de production, minimisant ainsi le gaspillage et prévenant les problèmes en aval.
RFT = (Nb de produits conformes sans retouche / Nb de produits fabriqués)La qualité n’est pas seulement une question de conformité, mais un impératif qui a un impact direct sur les résultats financiers et la viabilité à long terme de l’entreprise. Cela établit un lien fort avec les KPIs de « Rentabilité » et de « Délai Client« .
Les indicateurs de qualité sont des moteurs directs de l’expérience client et du succès commercial. Une livraison de produits de haute qualité, sans défauts et à temps (ce qui renvoie à l’OTD), renforce la confiance des clients et favorise les achats répétés. Inversement, un taux élevé de réclamations ou de défauts peut rapidement nuire à la réputation de la marque et entraîner une perte de clients, ce qui affecte les volumes de ventes futurs et la rentabilité. Cela met en évidence l’impact externe crucial de la performance qualité interne.
7. Les indicateurs de maintenance
Taux de disponibilité des Équipements
Le taux de disponibilité des équipements est un indicateur de performance de la maintenance industrielle. Il mesure la proportion du temps pendant lequel un équipement est opérationnel et prêt à produire. Cela permet d’évaluer l’efficacité de la gestion des actifs de production et d’identifier les pannes et tous les temps d’arrêt non planifiés.
Un taux de disponibilité élevé indique une bonne fiabilité des machines et une maintenance proactive. À l’inverse, un taux de disponibilité faible peut signaler des problèmes récurrents ou des inefficacités. Cet indicateur est à rapprocher du calcul du TRS qui inclut la même notion de disponibilité.
Taux de Disponibilité des Équipements = Temps de Fonctionnement réel / (Temps d'ouverture théorique - temps d’arrêts planifiés)
ou
Taux de Disponibilité des Équipements = MTBF / (MTBF + MTTR)Indicateurs associés au Taux de disponibilité des Équipements
MTBF
Le Mean Time Between Failures (MTBF), ou Temps Moyen Entre chaque Panne, représente le temps moyen qui s’écoule entre deux défaillances réparables d’un équipement ou d’un système. Il est important de noter que le MTBF ne prend pas en compte les temps d’arrêt planifiés pour la maintenance préventive ou d’autres interventions programmées.
Un MTBF élevé indique une grande fiabilité de l’équipement. Ce qui se traduit par moins de problèmes opérationnels et des arrêts de production moins fréquents. Et donc, cela contribue directement à une réduction des coûts.
Le MTBF sert également de signal pour les décisions d’investissement et de conception. Un MTBF constamment faible pour un actif ou un composant particulier devrait inciter à réévaluer sa conception, sa qualité de fabrication ou son adéquation à l’environnement opérationnel. Il fournit une justification, basée sur des données, pour les dépenses en capital destinées à l’acquisition de nouveaux équipements plus fiables ou à la refonte des systèmes existants pour améliorer leur fiabilité intrinsèque.
MTBF = Temps total de fonctionnement / Nombre de pannesMTTR
Le Mean Time To Repair (MTTR), ou Temps Moyen de Réparation, est le temps moyen nécessaire pour réparer une machine après qu’une défaillance se soit produite. Ce temps inclut toutes les étapes du processus de réparation : le diagnostic du problème, l’obtention des pièces de rechange nécessaires, la réalisation de la réparation elle-même et les tests finaux pour s’assurer que le système est pleinement fonctionnel.
Le MTTR est un indicateur direct de l’efficacité des opérations de maintenance. L’objectif principal est de maintenir ce temps aussi bas que possible afin de minimiser la durée des temps d’arrêt de production.
MTTR = Temps total d'arrêt pour maintenance / Nombre de réparationsÀ noter que les indicateurs de MTBF et MTTR nécessitent des relevés des équipes de maintenance bien souvent peu documentés dans les petites structures. L’utilisation d’une GMAO (Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur) garantira la structuration de ces données.
Coût de maintenance par rapport à la valeur des actifs
C’est l’indicateur le plus couramment utilisé pour évaluer l’adéquation du budget de maintenance par rapport à la valeur des équipements à maintenir. Pour le calculer, il faut être en mesure d’évaluer cette valeur de remplacement. Et parfois, c’est compliqué avec l’évolution des technologies, ne permettant pas un remplacement à l’identique). Les anciens équipements entièrement amortis, et donc avec une valeur nulle dans les bilans, doivent aussi être valorisés pour ne pas fausser la mesure.
Un ratio situé entre 2% et 5% est considéré comme “world class”. Si le ratio est inférieur à 2 %, cela peut indiquer une sous-maintenance, augmentant le risque de pannes coûteuses et non planifiées. Alors qu’un ratio supérieur à 5 % peut indiquer une sur-maintenance ou des problèmes récurrents nécessitant des coûts de réparation élevés.
Coût de maintenance = Coût total de maintenance annuel / Valeur de remplacement actuelle des actifs8. Les indicateurs de ressources humaines (RH)
Taux de rotation du personnel
Le taux de turnover, ou taux de rotation du personnel, représente le ratio entre le nombre d’employés quittant l’organisation et le total des effectifs sur une période définie, le plus souvent annuelle. Il peut englober à la fois les départs volontaires et involontaires (licenciements pour raisons économiques ou personnelles).
Un turnover élevé est un signe révélateur de problèmes sous-jacents au sein de l’entreprise, tels qu’une qualité de vie au travail insatisfaisante, des salaires non compétitifs, un manque de perspectives d’évolution ou des défis liés au management. Ces problèmes ont des conséquences, directes et indirectes, sur la performance globale de l’entreprise.
Si on se focalise uniquement sur la dimension industrielle, on peut identifier des impacts en termes de productivité. Une rotation trop importante déstabilise les effectifs, entraînant une baisse de l’efficacité due à la perte d’expérience, au temps nécessaire à la formation des nouvelles recrues (qui peut prendre jusqu’à 6 mois pour qu’elles soient pleinement opérationnelles) ou à la charge de travail supplémentaire imposée aux équipes restantes (parfois non capacitaires pour répondre à la demande).
Tout cela peut générer des retards en production et des problèmes de qualité. Et sur le plan social, le turnover peut impacter négativement la cohésion d’équipe, le moral des employés et la culture d’entreprise.
Cependant, il est important de noter qu’une absence totale de turnover n’est pas non plus souhaitable. Cela peut indiquer un immobilisme et freiner le dynamisme ou l’innovation au sein de l’entreprise.
Un taux de turnover compris entre 5% et 10% est souvent considéré comme sain, permettant un renouvellement bénéfique sans les inconvénients d’une rotation excessive.
Il existe plusieurs formules pour calculer le taux de turnover, les plus courantes étant :
Le taux d’attrition (standard) : Cet indicateur mesure le pourcentage de départs par rapport à l’effectif initial.
Taux d'attrition = (Nombre de départs / Effectif en début de période) Le taux de rotation global : Cette mesure complémentaire prend en compte à la fois les départs et les arrivées, offrant une vision plus complète du renouvellement global du personnel.
Taux de rotation = [((Nombre de départs + Nombre d'arrivées) / 2) / Effectif en début de période]La période de calcul recommandée est généralement annuelle, mais des analyses semestrielles, trimestrielles ou mensuelles peuvent être effectuées pour un pilotage plus opérationnel et pour détecter des tendances.
9. Les indicateurs de sécurité
Taux d’accident du travail
Le taux d’accident est un indicateur qui mesure la fréquence et/ou la gravité des accidents du travail survenant au sein d’une entreprise. Il n’est pas nécessaire de rappeler l’importance de la sécurité au travail qui engage la responsabilité pénale du dirigeant. C’est un devoir fondamental de veiller à ce que ses employés travaillent dans de bonnes conditions. Cependant, la sécurité a également un impact direct et significatif sur la productivité et les coûts opérationnels. Les accidents peuvent entraîner des pertes de journées de travail, des coûts d’indemnisation importants et une désorganisation de la production.
De plus, le taux de fréquence mesure le nombre d’accidents du travail avec arrêt pour un certain nombre d’heures travaillées.
Taux de Fréquence des accidents = (Nombre d'accidents / Heures travaillées) × 1 000 000.Ces taux sont des indicateurs clés pour les départements des ressources humaines et la direction. Ils leur permettent d’évaluer les métiers ou les services les plus exposés aux risques, et d’adapter en conséquence les équipements, les programmes de formation ou l’organisation du travail. Ils servent de guide pour les actions de prévention et contribuent à la maîtrise des coûts liés aux accidents, assurant ainsi une amélioration globale de la sécurité au sein de l’entreprise.
Indicateur associé au taux d’accident
Taux de Gravité
Le taux de gravité mesure la sévérité des accidents du travail en fonction du nombre de journées perdues (due à une incapacité temporaire) par rapport au nombre d’heures travaillées. Les journées perdues incluent tous les jours d’arrêt prescrits à la suite d’un accident. La formule de calcul est :
Taux de Gravité = (Nombre total de journées perdues pour accidents du travail × 1 000) / Nombre d'heures travaillées.10. Les indicateurs de respect de l’environnement
Intensité carbone
Les indicateurs liés au respect de l’environnement sont encore peu présents dans les tableaux de bord des usines, mais il faut parier qu’ils vont faire peu à peu leur entrée. La première mesure pertinente qui vient à l’esprit est bien sûr l’impact carbone.
L’empreinte carbone d’une usine se calcule globalement pour une année ou par mois. Néanmoins, il est intéressant de la calculer en déterminant la quantité de CO2 émise par tonne de matériaux transformés ou par pièce fabriquée. Le calcul peut se baser sur des facteurs d’émission physiques (quantité consommée multipliée par un facteur d’émission physique) ou monétaires (prix multiplié par un facteur d’émission monétaire).
Il est important de bien déterminer quel périmètre est inclus dans ce calcul entre les scopes 1, 2 et 3. Pour rappel, pour un site de production :
- Scope 1 : Émissions directes (Sources propres)
Il couvre les émissions de CO2 provenant de sources qui sont possédées ou contrôlées directement par l’usine de production elle-même, comme la combustion de gaz naturel pour des fours ou chaudières, le carburant consommé par les véhicules au sein de l’usine, les émissions chimiques ou physiques issues directement du processus de fabrication… - Scope 2 : Émissions indirectes liées à l’énergie (Achat d’énergie)
Cela englobe les émissions indirectes générées par la production de l’énergie (électricité, chaleur ou vapeur) qui est achetée et consommée par l’usine. Ces émissions se produisent physiquement dans la centrale électrique du fournisseur, et non sur le site de l’usine. - Scope 3 : Autres émissions indirectes (Chaîne de valeur)
Ce dernier scope est la catégorie la plus large et la plus complexe, car elle couvre toutes les autres émissions indirectes qui résultent des activités de l’usine mais proviennent de sources qui ne sont ni possédées ni contrôlées par l’entreprise. Elles couvrent toute la chaîne de valeur, en amont (fournisseurs) et en aval (clients).
La formule de calcul est donc la suivante :
Intensité carbone = Emissions de CO2 du scope 1, 2 et 3 / nombre d’unités fabriquéesIndicateur associé à l’Intensité carbone
Intensité énergétique
L’intensité énergétique d’un processus de production se définie par la quantité d’énergie consommée pour produire une unité. Une intensité énergétique élevée indique une faible efficacité énergétique. L’objectif est de la réduire, ce qui signifie que l’entreprise peut produire davantage avec la même quantité d’énergie, ou la même quantité avec moins d’énergie.
Dans un contexte de prix de l’énergie volatils et de réglementations environnementales de plus en plus strictes, l’intensité énergétique n’est plus seulement une métrique environnementale. Elle est devenue un indicateur financier et opérationnel.
Les entreprises affichant une faible intensité énergétique sont plus résilientes face aux chocs des prix de l’énergie. Elles bénéficient également de coûts d’exploitation réduits et sont donc intrinsèquement plus compétitives. Cela pousse à des investissements stratégiques (technologies éco-énergétiques, optimisation des processus ou sources d’énergie renouvelables) car elles ont un impact direct sur la rentabilité.
Cet indicateur peut être exprimé en énergie par unité monétaire (ex : kWh par million d’euros de valeur ajoutée) ou par unité physique (ex : kWh par tonne produite).
Intensité énergétique = Energie consommée pour la production / nombre d’unités fabriquéesConclusion
La véritable force d’un système de gestion de la performance ne réside pas uniquement dans le suivi de KPIs individuels, mais dans la compréhension de leurs interdépendances complexes. Une modification dans un domaine a inévitablement des répercussions sur d’autres, créant un réseau complexe de relations de cause à effet.
Un taux de turnover élevé peut nuire à la productivité et à la qualité. Un OTD fournisseur médiocre peut perturber la production et gonfler les coûts d’inventaire. Les problèmes de qualité érodent directement la rentabilité. Et ainsi de suite.
Pour atteindre l’excellence, il est impératif d’adopter une approche intégrée de la performance. Cela implique de définir des KPI de manière globale, en tenant compte de leurs effets en cascade. Il est essentiel de développer de tableaux de bord adaptés à chaque niveau de l’organisation, avec des indicateurs et des cibles déclinées des objectifs stratégiques de l’entreprise.
Cette structure doit favoriser le développement d’une culture d’amélioration continue où les données des indicateurs sont utilisées pour l’apprentissage et la résolution de problèmes à tous les niveaux de l’organisation.
Articles qui pourraient vous intéresser également :